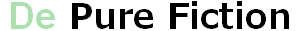A livre ouvert avec Emmanuelle Pagano

Une poignée de livres et Emmanuelle Pagano a fait entendre une voix. En résidence cet hiver à la maison De Pure Fiction, elle y écrivait – après un premier tome Ligne et fils – le deuxième opus de sa Trilogie des rives.
crédit photographe : Michel Roty
Racontez-nous où commence un livre
Un livre commence à l’endroit des interrogations, quand je me pose des questions, ou encore quand je rencontre ou découvre quelque chose ou quelqu’un et que je veux partager cette rencontre, cette découverte. Ces interrogations, ces rencontres ou découvertes, je ne peux pas faire autrement que les partager. Depuis longtemps écrire m’interdit de regarder n’importe quel paysage, les arbres, les gens, les objets, sans me demander comment les rendre, les représenter : elle me vole toutes mes rencontres, mes histoires, ma vie, elle ne me rend rien, presque rien, et moi je me sens toujours tenue de rendre, restituer tout ce qui me touche, m’occupe, me bouleverse. J’ai l’impression de ne pas pouvoir avoir directement accès au monde, de n’être qu’un instrument de perception. Peut-être même que je n’ai jamais eu accès à ce monde : dès lors je ne peux pas faire autrement qu’essayer de représenter ce monde qui se dérobe depuis l’enfance, et qui m’échappe encore. Je ne ressens plus ce qui vient de moi, ce qui est en moi, ni joie ni souffrance ni fatigue, ni même ce qui vient à moi. À l’inverse, je suis devenue perméable à tout ce qui se passe autour de moi, je recueille, j’absorbe les ressentis et les perceptions des autres comme si c’étaient les miens. Et ils sont envahissants. Alors si je voulais vraiment répondre honnêtement à cette question je devrais écrire qu’un livre commence comme tous les livres : là où on n’est pas ou plus capable de vivre, simplement vivre.
Avez-vous des rituels d’écriture ? Pouvez-vous nous dire ce temps suspendu de quand on écrit
Non, je n’ai pas de rituel d’écriture, sauf que j’ai besoin d’un espace propre et rangé pour poser mon matériel d’écriture : mon ordinateur portable. Mais j’écris d’abord sans m’asseoir, dans le balancement, la marche, le ménage, la conduite automobile, les voyages, les riens. J’écris d’abord dans ma vie de tous les jours, avec les autres, sans cesser de leur parler, de les écouter, sans cesser de répondre au monde autour de moi, j’écris dans ma vie, j’écris en mouvement. Je tiens mes livres en moi sans écrire à proprement parler, je les laisse venir et monter jusqu’à me dépasser, me déborder. J’emprunte un sentier de randonnée, je marche entre les pierres, je garde l’équilibre, mes phrases s’impriment au rythme de mes hanches, ou bien je passe l’aspirateur, méthodiquement, puis la serpillère, je m’endors, je rêve, je me lave, et, après, c’est différent, quand ça me déborde il faut écrire hors du corps, hors de la vie, hors du mouvement. Et loin des autres. Se rassembler. Il faut souffler. Comme toute petite je m’enfermais pour penser, je me retire pour écrire. J’écris en silence, mais avec toutes ces voix d’écrire que personne n’entend, et qui se mettent dans la mienne. Parfois je lis à haute voix, mais tout doucement, de peur que l’on m’entende, je chuchote mes livres pour éprouver le rythme des phrases, pour écouter la voix de la narratrice, quelle tessiture elle a, et aussi toutes ces autres voix du livre, celles des personnages.
Quand vous lisez, vous êtes où, vous êtes qui ? Que se passe-t-il alors ?
Je suis dans le livre, je suis le personnage illisible, la personne invisible du livre, celui à qui ce livre parle. Hors champ et pourtant là. Je deviens une de ceux sans qui aucun livre n’existe : les lecteurs. Je deviens un destinataire.
Si vous deviez être une phrase quelle serait-elle ?

Je suis vivante
Racontez-nous votre Il était une fois… une maison d’écrivains
Une maison où tout est prévu pour écrire, où l’on se sent bien pour écrire, sans trop de contrainte matérielles, avec de vastes bureaux vides, beaucoup de lumière naturelle et des lampes pour la tombée du jour. Mais aussi une maison dans laquelle on peut sortir pour marcher, pour se dégourdir les jambes et s’aérer les pensées après des heures passées devant l’ordinateur, donc idéalement tout près de beaux chemins (lorsqu’un ami a vu les photos de la maison De Pure Fiction que je lui avais envoyées, il s’est écrié : « ah ben en plus ils t’ont mis un chemin devant la maison ! »). Enfin une maison d’écrivains est remplie de livres, parce qu’écrire sans lire, ça me paraît impossible. Or ici, il y a tout ça…
Aux mots nature et horizon, à celui de Lot ou Midi-Pyrénées, par quels mots répondez-vous ?
Ce que j’aime dans la nature c’est le paysage, le pays : la nature travaillée par l’homme (flore et faune) et j’irai jusqu’à dire que pour moi, la nature ce sont les hommes. Plus je vis dans la nature, plus j’aime les hommes, et plus j’aime les hommes, plus je veux rester dans ce qu’on appelle la nature et que moi j’appelle « le pays ».
L’horizon est ce qui retient la vue, qui l’empêche de se perdre au loin, ou ce qui permet paradoxalement au regard de porter plus loin : de s’appuyer, de prendre de l’élan, de traverser. Ici, dans le Lot, et plus précisément sur les causses, l’horizon est souvent à la fois barré et souligné par les murs en pierres sèches, lorsqu’on est très près du sol ou en légère contreplongée (et moi je suis petite, alors ça marche souvent) ou bien par les frondaisons basses des chênaies. L’horizon est accessible, et laisse beaucoup de place au ciel. C’est un horizon de tremplins vers ce ciel. Ce type d’horizon est celui des plateaux, que j’affectionne particulièrement, et qui sont nombreux en Midi-Pyrénées (région de ma naissance et de toute ma famille maternelle, dans l’Aveyron). C’est aussi sur un plateau que je vis (en Ardèche), mais là où je vis c’est un plateau de plus haute altitude, moins confortable, plus rude, avec des contraintes qui empêchent parfois l’écriture.
Vous ferez quoi Emmanuelle Pagano quand vous serez grande ?
J’essaierai d’être une femme.