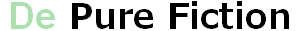L’amour qui prend tout ou qui perd tout…

Le quatuor d’Alexandrie
Lawrence Durrell- Editions La Pochothèque
On recule devant l’exercice, écrire sur un pareil roman ! S’il en est un autre, le voilà Le livre de sable. Cette poussière abrasive qui envahit le ciel alexandrin, écume d’une mer magnétique et portée par un tourbillon de vents, elle les embrase Justine, Balthasar, Mountolive et Clea. Ce quatuor défie le temps, il le malmène, le tord et le presse, il le chevauche et s’y perd. D’une phrase l’autre on est hier maintenant et demain, on est il ou elle et souvent eux. Une femme, une blessure, Justine, l’incandescence portée haut, le mystère nu qu’explorent maladivement ses comparses, amants et amantes malmenés et perdus. Eperdus. « Je compris alors la vérité de l’amour : un absolu qui prend tout ou qui perd tout. Les autres sentiments, la compassion, la tendresse et ainsi de suite, n’existent qu’à la périphérie, appartiennent aux constructions de la société et de l’habitude. Elle, l’austère et impitoyable Aphrodite, est une païenne. Ce n’est pas de notre cervelle ou de nos instincts qu’elle s’empare, mais de nos os et de notre moelle. » Ce pourrait être Justine l’obscure si elle n’était finalement là, que pour servir et incarner une ville qui dit le monde, Alexandrie capitale de la douleur. Et d’une beauté. Tout l’Orient est là, son vertige, frémissements et réminiscences, on lit comme on respire, et il semble à enchaîner les chapitre que l’on sent s’insinuer entre nos lèvres ce même philtre émanant du port, des ruelles et des impasses d’Alexandrie, cet entrelacs qui magnifie et fustige la pensée du narrateur préfacé ainsi par son auteur : « il pourrait porter ce sous-titre : un continuum de mots. Pour tenter d’élaborer ma propre forme romanesque, j’ai adopté, par approximation analogique, le principe de la relativité. » Pour Durrell et son lecteur il s’agit, on le comprend, de se libérer du temps, « La seule façon d’être fidèle au temps est d’intercaler les réalités », fait-il dire à Balthazar. « Tout ne dépend-il pas de l’interprétation que nous donnons du silence qui nous entoure ? » L’écoutant ce silence, on entend la voix singulière du plus foisonnant des romans ; nous livrant ses secrets, il envoûte, nous offre Alexandrie, altière et pervertie. « La mer était douce comme une joue humaine. Sur ses bords seulement elle bougeait un peu et soupirait. Ces baisers tièdes demeuraient là, en suspens dans leur présent, comme les fragiles transparences des fougères ou des roses séchées entre les pages d’un vieux livre – uniques et ineffaçables comme les souvenirs de la ville qu’elles évoquaient et symbolisaient; un flocon de musique tombé d’une guitare de carnaval oubliée, qui résonne dans les rues obscure d’Alexandrie aussi longtemps que dure le silence. »
Le quatuor d’Alexandrie – Lawrence Durrell – La Pochothèque