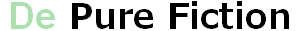Saint-Étienne de Calvignac, mille ans, porte bien son âge…

Guillaume de Fonclare
lors de sa résidence d’écriture à la maison De Pure Fiction
De mon repaire sur les hauteurs du Causse, je vole d’église en église depuis mon arrivée. De la petite Saint-Étienne de Calvignac à la majestueuse collégiale Notre-Dame à Villefranche-de-Rouergue, je n’ai de cesse d’en visiter les arcanes de pierres; de loin en loin, j’étends mon aire jusqu’à Cahors, Conques, Figeac, Rodez. Moi, l’athée pratiquant, je découvre en ces vaisseaux de calcaire une sorte de quiétude que je n’éprouve nulle part ailleurs, une sérénité doublée d’une grâce qui me ferait presque croire en la présence de quelque chose de plus grand que nous, une forme d’existence supérieure à l’espèce humaine. Peut-être que les prières des milliers de pèlerins qui se sont succédé dans ces lieux de culte se fondent-elles aux murs ; j’en trouve encore la trace dans les ex-voto scellés aux chœurs de ces églises, ou dans la couche dense de cire jaunie qui colmatent le fond des porte-cierges. Règne au fond du silence le temps épais des aspirations aphones ; je n’aime rien autant qu’une foule de fidèle perdue dans ses prières muettes, ce grand feu collectif des âmes qui s’élèvent vers le ciel. De tous les trésors contemplés sur le Causse, ce sont les nefs, chœurs, transepts qui vont le plus me manquer ; en nulle autre lieu qu’ici, je ne trouverai cette patine millénaire aux façades des églises, ce Roman épanoui ou ce Gothique un peu austère que j’apprécie tant et qui font mon bonheur.
A Saint-Étienne de Calvignac, j’ai découvert la simplicité rustique d’un temple presque païen, un petit porche qui fait l’entrée, une courte nef, et un chœur minuscule. Une église à hauteur d’homme, aux pavés disjoints et polis par le temps, et la cohorte silencieuse de générations de fidèles ; une église de mille ans, qui porte bien son âge.
La collégiale Notre-Dame de Villefranche-de-Rouergue fait dans le grandiose ; une belle tour-porche typique du Gothique méridional, une seule nef longue qui se confond avec le chœur, pas de transept, des fenêtres hautes et étroites, on se croirait presque dans un château fort, une forteresse du dogme en plein midi hérétique. Construite au XIIIe siècle, elle a pour vocation de proclamer la toute-puissance de l’Église apostolique et romaine en ces terres anciennement cathares. Elle affirme que l’église est forte, unie, indestructible. Elle a la beauté austère, altière, et souveraine.
Conques ! Conques ! La foi incarnée dans la pierre, la rudesse d’une pratique – celles des moines bénédictins – appliquée à l’architecture. Montrer, démontrer que Dieu n’est que puissance et domination, en même temps que paix et commisération. Conques est un joyau dont la Nature est l’écrin ; Conques est ordre et harmonie au milieu du plus sauvage désordre. L’abbatiale Sainte-Foy de Conques est l’un de ces endroits qu’il faut visiter avant de quitter ce monde, ce chef-d’œuvre de l’art roman représentant, au-delà d’être un haut lieu du Christianisme, l’une des plus belles réalisations de l’homme lorsqu’il se donne la peine de travailler de concert.
Sur le Causse, la beauté est partout ; au portail des églises, aux ramures des forêts, et au carrefour des routes, une foule de petits calvaires de pierre, forme primaire de la piété. Profane et religieux se confondent en tout lieu, et cette terre est pétrie de croyances ; dolmens en quantité, pierres dressées, la dévotion est de tout âge. Profane et sacré se lient intensément, et la Nature en profusion est un temple pour qui espère. Depuis l’aube de l’humanité, les prêtres ont voulu mettre en ordre le chaos, et comprendre ce que le ciel leur murmurait. « La Nature est un temple où de vivants piliers Laissent parfois sortir de confuses paroles… »
Las ! Il va falloir partir, et quitter le monde parfait des dévotions naturelles, de la piété ardente, où profane et spirituel se rejoignent d’une si parfaite manière. Retrouver nos villes, et nos cœurs embrumés, retrouver le bruit, la foule, le temps qui passe aux montres des poignets, la fureur de la vie moderne où la beauté n’a nulle place, où la spiritualité est de pacotille. On nettoie du goudron qui les tache les façades des églises, les pissenlits se meurent au talus des autoroutes, et rien ne paraît se faire d’une naturelle façon. Il va falloir quitter le Causse, et revenir au concret imbécile des cités contemporaines ; loin du plateau, des aubépines, des chênes verts, on va faire semblant de vivre, dans le regret éternel de ce que l’on aura laissé.