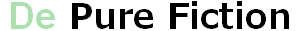La vitesse des arbres immobiles… (suite 1)

Shmuel T. Meyer
lors de sa résidence d’écriture ce printemps à la maison De Pure Fiction
Est-ce l’excès de sang, un flux trop puissant, trop neuf, qui frappe à ma tempe ? Est-ce la robe caramélisée des vapeurs hashichéennes qui embrume ma tête ? Je vois l’extension du vert et les ombres du vert, le rythme loufoque et triste des douloureux chênes et cet infini printemps végétal qui submerge toute tentative de mélancolie. Il est là, partout, conquérant à l’assaut du causse, posant sur toute pierre, toute mousse, l’innocente superficialité de sa naissance.
Dimanche 23 avril. Passent sous ma fenêtre des marcheurs qui ne vont nulle part. Ils avancent, bâtons élaborés en laboratoire d’ergonomie, comme de gros échassiers. Grégaires, ils font troupeau sans pâturage. Leur berger sait lire une carte d’état-major. Nul pèlerinage, procession, traversée du désert. Nulle destination si ce n’est l’épuisement de leur méchantes chaussettes au cuir huilé de leurs souliers.
Lundi 24 avril. Il fait très beau. Des salauds de la météorologie nationale m’annoncent qu’il va pleuvoir cette semaine. Comprenez-moi bien. Je n’ai rien contre la pluie, l’hiver, le froid, mais juste en hiver. Au printemps je suis plus revendicatif.